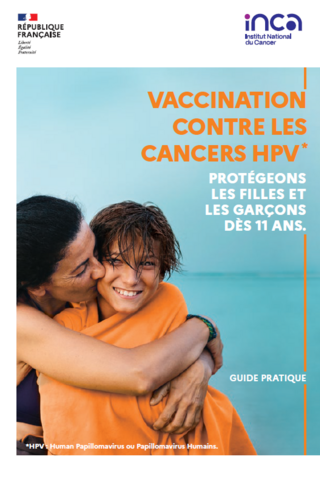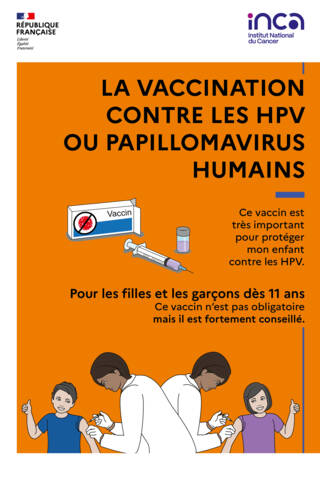La vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains (HPV) pour prévenir les cancers
Updated on
Chaque année, en France, 7 130 nouveaux cas de cancers sont attribuables aux infections liées aux papillomavirus humains (HPV) alors qu’il existe une vaccination sûre et efficace.
Afin d’augmenter la couverture vaccinale plusieurs leviers sont mis en place : amélioration de l’accessibilité au vaccin (avec notamment la possibilité de se faire vacciner en officine ou au collège) ou encore élargissement des bornes d’âge éligibles au rattrapage vaccinal jusqu’à 26 ans.
La vaccination contre les HPV est recommandée pour :
- les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans, avec un schéma vaccinal en 2 doses ;
- les filles et les garçons âgés de 15 et 19 ans, en rattrapage, avec un schéma vaccinal en 3 doses ;
- les jeunes adultes de 19 à 26 ans révolus n'ayant pas été vaccinés à l’adolescence, avec un schéma vaccinal en 3 doses ;
- les filles et les garçons en attente ou ayant eu une transplantation d’organe dès l’âge de 9 ans.
Depuis la rentrée scolaire 2023, la vaccination contre les HPV est proposée gratuitement dans les collèges aux élèves de 5e et de 4e, avec l’autorisation de leurs parents.
Pour vous accompagner dans l’information des parents, l’INCa vous propose :
- les arguments clés en faveur de la vaccination contre les cancers HPV
- l’infographie dynamique qui explique ce que sont les cancers HPV induits et le rôle de la vaccination contre les HPV
- des affiches pour les pharmacies afin de sensibiliser les clients à la vaccination contre les HPV
Vacciner les adolescents contre les HPV dès l'âge de 11 ans
Les vaccins contre les HPV sont des vaccins préventifs : ils n'ont aucune efficacité sur une infection en cours. C’est pourquoi il est nécessaire de vacciner les adolescents avant qu’ils ne soient infectés. Par ailleurs :
- les données scientifiques montrent que la réponse immunitaire est meilleure lorsque le vaccin est administré avant 15 ans plutôt qu’après ;
- la vaccination contre les infections liées aux HPV peut être réalisée lors du rendez-vous vaccinal pour le rappel dTcaP (diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite), prévu entre 11 et 13 ans ; et/ou avec l’administration d’un vaccin méningococcique tétravalent ACWY, prévu entre 11 et 14 ans et/ou d’un vaccin contre l'hépatite B ;
- si la première dose du vaccin est administrée dès 11 ans (et jusqu’à 13 ou 14 ans en fonction du vaccin), seules deux doses seront nécessaires ;
- l’absence de distinction selon le sexe et l’orientation sexuelle est un moyen de simplifier la proposition vaccinale, en particulier à un âge où l’orientation sexuelle n’est pas encore connue ou affirmée.
Extension du rattrapage vaccinal HPV jusqu'à 26 ans
Une opportunité à saisir pour les 19-26 ans
Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), pour les jeunes adultes de 19 à 26 ans révolus n'ayant pas été vaccinés à l'adolescence, le schéma vaccinal recommandé est de trois doses du vaccin Gardasil9®, administrées selon le calendrier suivant :
| Schéma vaccinal | |
| 1re injection | Entre 19 et 26 ans |
| 2e injection | 2 mois après la 1ère injection |
| 3e injection | 6 mois après la 1ère injection |
> Consulter le calendrier vaccinal du ministère en charge de la santé
Cette recommandation est détaillée dans le document « Vaccination contre les papillomavirus : élargissement de la cohorte de rattrapage vaccinal chez les hommes et les femmes jusqu’à 26 ans révolus. »
La HAS souligne que la protection conférée par le vaccin est optimale lorsqu’il est administré le plus tôt possible. Cependant, elle note également que la majorité des jeunes adultes jusqu’à 26 ans n’ont pas encore été exposés aux infections par le HPV mais sont à risque élevé de les acquérir et de les transmettre.
Il est important de noter que le vaccin Gardasil9® peut être administré de manière concomitante avec d'autres vaccins recommandés pour les jeunes adultes, tels que le rappel dTcaP (diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite) à l’âge de 25 ans, ou la vaccination de rattrapage contre les infections invasives à méningocoques (vaccins ACWY), recommandée entre 15 et 24 ans.
La vaccination en pratique
Toute nouvelle vaccination doit être initiée avec le vaccin Gardasil9®. Les vaccins ne sont pas interchangeables et toute vaccination initiée avec le Cervarix® doit être menée à son terme avec le même vaccin, aussi longtemps qu’il sera disponible.
Le vaccin Gardasil9® est indiqué pour l‘immunisation active des filles et garçons contre :
- les lésions précancéreuses et/ou cancers du col de l‘utérus, mais aussi de la vulve, du vagin et de l‘anus, pour lesquels il n’existe pas de dépistage ;
- les verrues génitales (condylomes acuminés).
Les schémas vaccinaux diffèrent suivant le vaccin utilisé et l'âge. Le vaccin Gardasil9®, recommandé pour tout nouveau schéma vaccinal depuis 2019, protège des infections par HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58.
Schémas vaccinaux de référence avec Gardasil9®
| 1er schéma vaccinal | 2e schéma vaccinal | |
| 1re injection | Entre 11 et 14 ans | Entre 15 et 26 ans |
| 2e injection | de 5 à 13 mois plus tard | 2 mois après la 1ère injection |
| 3e injection | 4 mois après la 2e injection |
L'une de ces doses peut être co-administrée avec le rappel dTcaP (diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite) prévu entre 11 et 13 ans, ou avec un vaccin contre l'hépatite B dans le cadre d'un rattrapage vaccinal ; le rappel dTcaP peut se faire jusqu’à à l’âge de 25 ans ainsi que la vaccination de rattrapage contre les infections invasives à méningocoques (vaccins ACWY), recommandée entre 15 et 24 ans. Toute vaccination initiée avec l'un d'eux doit être menée à son terme avec le même vaccin.
Il est essentiel de respecter le schéma vaccinal. Toutefois, lorsqu'il est interrompu, il n'est pas nécessaire de refaire un schéma complet : il est possible d'administrer la (ou les) dose(s) manquante(s) au-delà de l'intervalle recommandé.
La vaccination contre les HPV est préventive : les vaccins n'ont aucune efficacité sur une infection en cours.
Les données actuelles montrent que la durée de protection contre les lésions précancéreuses du col de l’utérus liées aux HPV 16 et 18 est d’au moins 4 ans. Aucune donnée n’est disponible pour l’instant sur la nécessité d’un rappel.
La vaccination contre les HPV est prise en charge à 65% par l’Assurance Maladie, le montant restant étant généralement remboursé par les complémentaires santé (mutuelles). Cette vaccination peut être réalisée chez un médecin, pharmacien, sage-femme ou en centre de santé.
Elle peut être prise en charge à 100 % jusqu’à 26 ans, pour les personnes qui bénéficient de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS). C’est également le cas dans certains centres de vaccination municipaux et départementaux.
Cas particuliers
- Pour les patients candidats à une transplantation d'organe solide : la vaccination contre les HPV est recommandée chez les garçons comme les filles aux mêmes âges que dans la population générale, avec un rattrapage jusqu'à l'âge de 26 ans révolus. Chez les enfants des deux sexes, candidats à une transplantation d'organe solide, la vaccination peut être initiée dès l'âge de 9 ans conformément à l’AMM du vaccin.
- Vaccination des personnes vivant avec le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) : la vaccination est recommandée dès 11 ans et jusqu’à 26 ans avec un schéma à trois doses avec Gardasil9®. Les taux d’incidence sont plus élevés chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH), en particulier chez ceux qui sont séropositifs au VIH. Ces derniers présentent un risque 100 fois plus élevé par rapport aux hommes en population générale.
Les infections liées aux HPV
Les HPV sont des infections sexuellement transmissibles très fréquentes, contractées généralement au tout début de la vie sexuelle, même sans pénétration.
Il existe près de 200 types de HPV, dont certains sont cancérogènes (on en dénombre 12, également désignés comme virus à haut risque). Les HPV à haut risque oncogène 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 sont responsables de 90 % des cancers du col de l’utérus, 70 % des cancers du vagin, 40 % des cancers de la vulve, 85 % des cancers de l’anus, 60 % des cancers du pénis et de 80 % des lésions précancéreuses de haut grade.
Les HPV 6 et 11 sont responsables des verrues génitales ou condylomes.
La transmission des HPV se fait par contact avec la peau et les muqueuses, le plus souvent lors de rapports sexuels, avec ou sans pénétration. Le préservatif peut limiter le risque d’infection mais n'assure pas une protection efficace.
La plupart des hommes et des femmes ayant une activité sexuelle seront infectés à un moment de leur vie. Si les infections à HPV disparaissent la plupart du temps naturellement, en quelques mois, elles peuvent persister dans certains cas et évoluer vers un cancer (col de l’utérus, vagin, vulve, anus, pénis, oropharynx).
Chaque année en France, 7 130 nouveaux cas de cancers sont causés par les HPV, dont presque 100 % des cancers du col de l’utérus.
De plus, 30 000 lésions précancéreuses ou cancéreuses du col de l’utérus sont dépistées chaque année et peuvent faire l’objet de gestes chirurgicaux, avec parfois des retentissements importants sur l’avenir obstétrical de la femme, comme des risques d'accouchement prématuré.
Près de 29 % des cancers provoqués par les HPV surviennent chez les hommes.
Aujourd’hui en France, la vaccination prévient jusqu’à 90 % des infections à l’origine des cancers.
Efficacité, sécurité et surveillance des vaccins
La vaccination contre les infections à HPV bénéficie d’un recul de plus de 15 ans, avec plus de 300 millions de doses administrées dans le monde et une introduction de cette vaccination dans les programmes nationaux de tous les pays d’Europe depuis 2018. La surveillance post-AMM (autorisation de mise sur le marché) repose sur un plan de gestion des risques actif à l’échelle européenne et nationale, permettant la détection d’éventuels effets indésirables en vie réelle.
Les données recueillies à l’échelle internationale n’ont mis en évidence aucun signal remettant en cause la balance bénéfices-risques de ces vaccins. Le Comité consultatif pour la sécurité des vaccins de l’OMS (GACVS) a considéré le vaccin anti-HPV comme « extrêmement sûr » dès 2017.
Les principaux effets sont bénins et transitoires :
- réactions au point d’injection (rougeur, douleur, démangeaisons),
- fièvre modérée, céphalées,
- plus rarement, syncopes vaso-vagales, justifiant une surveillance de 15 minutes après injection.
Les personnes recevant le vaccin doivent être surveillées pendant 15 minutes après l'injection du vaccin.
Des craintes ont été exprimées concernant un lien entre vaccination HPV et pathologies auto-immunes. Une étude française menée par l’ANSM et l’Assurance maladie sur 2,2 millions de jeunes filles n’a montré aucun sur-risque de maladies auto-immunes ni de sclérose en plaques après vaccination par Gardasil® ou Cervarix® (source : ANSM / CNAM). Les rares signaux explorés (SGB, MICI) n’ont pas été confirmés par des études internationales : étude cas-témoins anglaise sur 10,4 millions de doses et étude québécoise.
Les données australiennes confirment une réduction significative :
- Des génotypes HPV oncogènes (- 77 % des 75 % des cancers du col de l’utérus),
- Des lésions précancéreuses cervicales de haut grade (- 50 % chez les filles de moins de 20 ans).
La première observation d’une association entre vaccination et réduction du risque de cancer du col de l’utérus a été publiée à partir du registre des cancers suédois en 2020. Sur la période 2006-2017, l’observation des cancers survenus chez les femmes âgées de 10 à 30 ans a permis de mettre en évidence un risque de cancer invasif du col de l’utérus inférieur chez les jeunes femmes ayant reçu a minima une dose de vaccin quadrivalent contre les HPV (ratio d’incidence en analyse multivariée : 0.37 (95% CI, 0.21 to 0.57), avec une réduction plus marquée chez celles vaccinées avant l’âge de 17 ans (ratio d’incidence en analyse multivariée : 0.12 (95% CI, 0.00 to 0)).
Des augmentations du taux de cancer du col de l’utérus chez les femmes de moins de 50 ans ont été observées dans certains pays ayant mis en place la vaccination (Suède, Japon, Angleterre). Ces augmentations d’incidence ont été attribués à tort à la vaccination alors que les données disponibles ne montrent aucun lien. Au contraire, elles plaident en faveur de la nécessité de promouvoir la vaccination.
À l’issue de la campagne, en tenant compte des vaccinations réalisées en ville et au collège, la couverture vaccinale (CV) contre les infections à HPV des enfants nés en 2012 et affiliés au régime général de l’Assurance Maladie était estimée pour deux doses, à 35 % chez les filles et à 27 % chez les garçons. Il est observé, entre le début et la fin de la campagne, une augmentation de 16 points chez les filles et de 13 points chez les garçons.
Expliquer les adjuvants à vos patients
Les vaccins contre les infections liées aux HPV, comme la plupart des vaccins inactivés, contiennent des adjuvants qui conditionnent leur efficacité.
Les sels d’aluminium figurent parmi les adjuvants les plus utilisés dans le monde, avec un recul d’utilisation de 90 ans et des centaines de millions de doses injectées.
Complémentarité entre vaccination et dépistage
La vaccination contre les infections liées aux HPV est un moyen complémentaire au dépistage par prélèvement cervico-utérin ou test HPV pour éradiquer le cancer du col de l’utérus.
Les vaccins ne protégeant pas contre tous les HPV responsables des cancers du col de l’utérus, la stratégie de prévention globale de ce cancer s’appuie sur une complémentarité entre vaccination et dépistage par prélèvement cervico-utérin (jusqu'à 29 ans révolus) ou test HPV (à partir de 30 ans).
Depuis 2018, un programme national de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus a été mis en place. La vaccination permet de réduire le nombre de lésions pré cancéreuses et cancéreuses du col utérin dépistées et traitées, et ainsi d’en réduire les conséquences sur la vie obstétricale de la jeune femme.
Liens utiles
- L'infographie dynamique sur les HPV
- Calendrier vaccinal en vigueur (ministère en charge de la Santé)
- Vaccination Info service - Espace professionnel
- La vaccination contre les HPV : le point sur les infox
Pour aller plus loin
- Le dossier thématique de l'ANSM
- Vaccination contre les infections à HPV et risque de maladies auto-immunes : une étude Assurance maladie/ANSM rassurante (point d’information du 13 septembre 2015)
- Info-HPV sur le site de l’Institut Pasteur (espace professionnels)
- Santé Publique France
- Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)
- Organisation mondiale de la Santé (OMS)
- Avis du HCSP relatif à la vaccination contre les infections à HPV chez les hommes (février 2016)
- Recommandation de la HAS pour l’élargissement de la vaccination aux garçons (décembre 2019)
- Modélisation sur les bénéfices attendus de l'augmentation de la couverture vaccinale en France